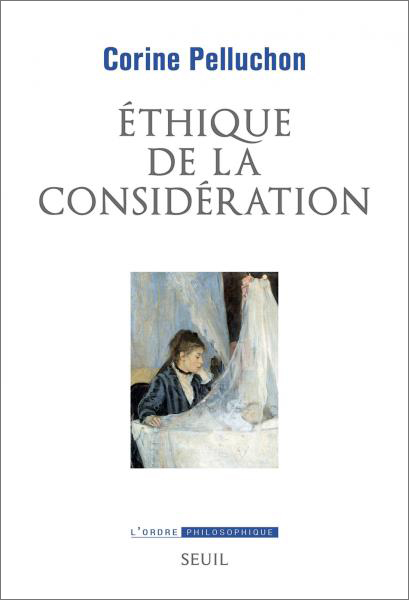Lettre ouverte à Corine Pelluchon à propos de son livre Éthique de la considération
Par Olivier Maurel, avril 2022
Madame,
Ce qui m’a attiré vers votre livre Éthique de la considération, c’est le rapport entre la belle reproduction du tableau de Berthe Morisot, Le Berceau, qui orne sa couverture et l’idée de considération. Comme je travaille moi-même depuis plus de vingt ans sur la violence manifestée à l’égard des enfants et sur la nécessité de les traiter avec respect, le rapprochement établi par cette couverture ne pouvait qu’attirer mon attention.
J’ai donc suivi avec confiance le début de votre raisonnement, qui n’aborde le thème de l’enfance qu’à partir du milieu de votre livre.
Je n’ai pu qu’approuver votre objectif de « destituer le principe de domination » et « le remplacer par le principe de considération » (p. 300).
Vous estimez en effet avec raison que la plus grande menace sur notre avenir et celui de nos descendants est la compétition des ambitions aussi bien économiques et financières que politiques qui ont lancé l’humanité dans une course à la puissance qui risque de détruire les conditions même de la démocratie d’abord, et de notre survie à plus long terme.
L’éthique de la considération vous semble être à juste titre l’antithèse de la domination. Considérer, c’est à la fois respecter, aimer, admirer. « La considération suppose de regarder avec attention chaque chose en appréciant sa valeur propre » (p. 235). Quand on considère vraiment ce qui est autre par rapport à nous, c’est-à-dire les autres êtres humains, y compris les plus faibles et les plus méprisés, mais aussi les animaux et la nature dont nous faisons partie, on ne peut plus se permettre d’avoir une attitude et un comportement de domination, d’exploitation sans limite et de destruction. Vous cherchez donc à donner ou à redonner aux individus cette attitude intérieure de la considération qui, seule, peut nous permettre d’édifier les indispensables institutions sociales et politiques qui permettront à la fois la convivialité entre les êtres humains, entre l’humanité et les animaux, entre l’humanité et son milieu naturel.
Vous montrez également que « le point de départ de l’éthique de la considération est la subjectivité, et non Dieu » ni des principes abstraits. « Aucune règle, écrivez-vous, ne peut fournir de repère véritable ni se substituer à l’individu. » (p. 291). Il est donc impossible de faire l’économie de ce que vous appelez le processus d’individuation, c’est-à-dire d’une transformation intérieure. Je crois comme vous que l’individu est la véritable source de l’éthique et que les meilleures institutions du monde ne pourraient se maintenir si une majorité d’individus ayant gardé l’intégrité de leur personnalité ne faisaient sans cesse pression pour leur maintien.
Pour favoriser le processus d’individuation, vous convoquez le « concile des philosophes » et vous passez en revue toutes les vertus autrefois exaltées par les philosophes et qui peuvent nous amener à l’attitude que vous souhaitez voir se développer : la considération. Pour vous, « sans une transformation profonde des personnes, de leurs représentations, de leur manière d’être et de leur imaginaire, il n’y aura pas de réorientation de l’économie et les réponses aux crises seront des réponses autoritaires, voire totalitaires » (p. 300).
Cette transformation, vous cherchez à ce qu’elle ne découle pas seulement d’un sentiment de devoir qui, par sa pénibilité, nous rendrait malheureux. Vous pensez possible et nécessaire qu’elle produise en nous le plaisir de faire le bien par le sentiment d’appartenir avec tous les vivants à un monde commun.
Jusqu’ici, je vous suis. Et j’aurais aimé vous suivre plus loin.
Mais lorsque vous énumérez les obstacles que nous risquons de rencontrer sur le chemin de la considération, je ne peux plus vous suivre, pour deux raisons.
D’abord, vous évoquez un obstacle qui me semble imaginaire mais dont la simple évocation affaiblit votre argumentation. Et ensuite, comme malheureusement beaucoup de philosophes, vous ne tenez aucun compte d’un fait massif qui pourtant, si vous en reconnaissiez l’importance, renforcerait considérablement votre entreprise.
Les principaux obstacles, selon vous, sont nos « pulsions » : pulsions sexuelles, pulsion d’agressivité, pulsion de mort. Bref, toutes les composantes de la théorie des pulsions de Freud (qu’on peut remettre en question, comme l’ont fait un bon nombre de psychanalystes, sans pour autant remettre en question toute la psychanalyse).
Or, cette théorie, qui n’a jamais eu de base scientifique, est considérée comme obsolète dans la plupart des pays du monde. Freud l’a inventée après la mort de son père dont il savait qu’il avait abusé sexuellement de plusieurs de ses enfants, c’est-à-dire dans des circonstances qui peuvent la rendre d’autant plus suspecte. Alors qu’il avait d’abord bien perçu l’importance et la fréquence des abus sexuels sur les enfants, brusquement Freud a décidé de considérer que ces abus étaient fantasmés, et qu’ils n’avaient aucune réalité. D’après lui, ces fantasmes résultaient des « pulsions » des enfants : pulsions sexuelles, pulsion d’inceste, de parricide et, plus tard, pulsion de mort, donc de destructivité. Tout le mal viendrait de là, donc du fond de nous-mêmes, de notre inconscient et, comme vous le dites, « de notre organisme lui-même », ce qui ferait « qu’on ne peut ni les fuir ni s’y soustraire » (p. 204).
Ce qui m’a personnellement amené à ne plus du tout croire à la théorie des pulsions, qu’on m’avait appris à prendre au sérieux dès la classe de philosophie, c’est le fait que, depuis plus de vingt ans, j’étudie la façon dont les enfants ont été traités dans le passé et dans le présent. J’ai découvert à ma grande surprise que partout, dans toutes les civilisations dotées d’une écriture (qui nous permet de connaître les méthodes d’éducation du passé), les enfants ont été traités, non pas par cruauté mais par principe d’éducation, avec une violence inouïe. Le bâton, le fouet et une multitude de formes de punitions variables selon les sociétés, sans compter les formes de violences verbales et psychologiques, ont été l’accompagnement des années durant lesquelles le cerveau des enfants se formait. Vous qui insistez avec raison sur la « corporéité du sujet », vous pouvez facilement imaginer les ravages causés chez les enfants et les adolescents et les adultes qu’ils sont devenus par de tels traitements. Et ils sont encore infligés aux enfants dans la majorité des pays du monde. Seuls 63 pays aujourd’hui (sur 195) ont interdit toutes les formes de violence physique aussi bien dans les familles qu’à l’école, mais même dans les pays où cette interdiction a été votée, beaucoup de temps sera encore nécessaire pour qu’elle entre vraiment dans les mœurs.
Mais le plus surprenant, c’est que cette violence aberrante sur des êtres humains, à l’âge où ils sont le plus fragiles et le plus vulnérables, la plupart des grands philosophes soit l’ont approuvée soit n’en ont en rien tenu compte. Ils ont disserté sur la nature humaine comme s’ils pouvaient l’observer dans son état normal, alors qu’en réalité ils n’avaient sous les yeux, et dans les œuvres historiques qu’ils pouvaient lire, que des êtres victimes, tout au long de leurs premières années et souvent jusqu’à leur majorité, d’extrêmes violences et profondément perturbés par elles. D’où les comportements souvent aberrants, cruels et inhumains dont l’histoire regorge. Tous les tyrans, autocrates et dictateurs ont eu des enfances ravagées par la violence de leurs parents et/ou de leurs maîtres. Et tous les peuples qu’ils ont soumis ont été dressés à la soumission par la même éducation. Nous le savons aujourd’hui parce que nous connaissons les séquelles de la maltraitance. Mais dans le passé, très rares ont été les écrivains conscients des effets de la violence sur les enfants : Plutarque, Quintilien en ont brièvement et intelligemment parlé, mais ce qu’ils en ont dit n’a pu avoir qu’une influence très limitée. Même La Boétie, qui s’est interrogé sur l’origine de la servitude humaine, non seulement n’a pas vu son lien avec la méthode d’éducation la plus universelle, mais a même considéré cette méthode comme bienfaisante. Ce n’est qu’à partir du XVIe siècle, avec Érasme, Rabelais et Montaigne que, grâce à l’imprimerie et à la vulgarisation des idées humanistes qu’elle a permise, une prise de conscience commence à se manifester parmi les pédagogues et les intellectuels, même si, dans la pratique des familles et des écoles, la violence est restée la méthode la plus habituelle d’éducation.
Or, parmi les intellectuels à qui a manqué la prise de conscience de la généralité de la violence éducative, il y a Freud. Il s’est contenté de déconseiller la fessée, mais sans chercher plus loin. Ce sont seulement certains de ses disciples qui ont mieux vu que lui les effets destructeurs des violences physiques sur les enfants.
Non seulement Freud, comme malheureusement la quasi-totalité des philosophes du passé, a disserté sur la nature humaine sans tenir compte du dressage violent systématique qu’elle subit dans les années d’enfance, mais en plus il a attribué aux enfants des pulsions violentes qui seraient la cause de tous nos malheurs. Il a accusé Œdipe et exonéré de toute culpabilité Laïos qui, dans le mythe, est pourtant le véritable coupable.
Mais il y a plus encore. Ce que depuis Freud a découvert la science actuelle, ce sont les extraordinaires capacités relationnelles innées avec lesquelles les nouveau-nés, dont vous parlez si bien, viennent au monde. Tout simplement parce que nous sommes, depuis des centaines de milliers d’années, des animaux sociaux dont le cerveau a été câblé par l’évolution, les enfants naissent dotés de capacités relationnelles innées qui, si elles trouvent leur répondant chez les adultes qui les accueillent, les poussent à vivre avec leurs semblables, sinon en harmonie parfaite, du moins en harmonie relative. Ces capacités sont l’attachement, mis en lumière par Bowlby et confirmé depuis par de nombreuses études sur la psychologie des enfants, l’imitation, source de tous les apprentissages, l’empathie, qui fait que la souffrance des nouveau-nés se transmet des uns aux autres par le biais de leurs pleurs, l’altruisme, qui apparaît très tôt chez les enfants, le sens de la justice, et même la capacité très importante de réfléchir avant d’obéir à un ordre.
Ne vous semble-t-il pas que l’universalité de l’éducation violente depuis des millénaires, avec la relation de domination qu’elle établit sur les enfants, est une explication beaucoup plus vraisemblable de la tendance à la domination, et beaucoup mieux établie scientifiquement, que la très peu vraisemblable théorie des pulsions ?
Ce ne sont pas les prétendues « pulsions » imaginées par Freud qui font notre malheur. Le mal, la violence, la volonté de domination ne naissent pas en nous mais entre nous. Plus précisément dans la relation de domination établie par les adultes sur les enfants. Il est intéressant de voir que la libido dominandi a été définie par saint Augustin, victime lui-même de violences dans son enfance de la part de ses maîtres et de moqueries de ses parents quand il leur racontait ce qu’il avait subi. Il a commencé par s’en plaindre, puis il a prétendu que ces violences étaient justes en définitive, si grand était son péché comme celui de tous les enfants. Après saint Augustin, Machiavel et Hobbes, sans tenir aucun compte de l’universalité de l’éducation violente, ont prétendu eux aussi que le désir de dominer était profondément inscrit dans l’âme humaine. Et il est vrai que le désir de dominer est fréquent dans l’humanité. Mais est-il raisonnable d’attribuer l’origine de ce désir à la nature des enfants, alors que la quasi-totalité des enfants sont soumis depuis des millénaires au puissant exemple de la domination violente des adultes tout au long des années de leur formation ? Comment leur tendance à l’imitation ne les amènerait-elle pas à suivre cet exemple et à chercher à dominer ou à accepter de se soumettre, ce qui n’est pas mieux ? J’ai eu cinq enfants qui m’ont donné huit petits-enfants et une arrière-petite-fille, auxquels il faut ajouter les trois mille élèves que j’ai eus dans mes classes au cours de ma carrière de professeur. La conviction que j’ai tirée de mes relations avec eux, c’est que les enfants respectés et considérés, fût-ce parfois par une seule personne, ne cherchent pas à dominer. Ils cherchent à retrouver le rapport de respect et de considération à égalité qui leur a fait du bien. Et que les enfants qui établissent des relations de violence, de mépris et de domination ne font que reproduire ce qu’ils ont subi quand leur cerveau était en pleine formation.
Vous savez certainement que les chasseurs-cueilleurs n’ont souvent aucune attitude de soumission à l’égard de leurs chefs. Dans sa Relation de ce qui s’est passé en nouvelle France en l’année 1633, le jésuite Paul Lejeune raconte que les Indiens Montagnais, qui refusaient que les enfants soient frappés, se moquaient aussi du respect que le jésuite manifestait à l’égard du roi de France, comme ils se moquaient ouvertement de leur propre chef. Pierre Clastres l’a confirmé bien plus tard. Cela aussi porte à penser que l’esprit de domination et d’obéissance n’est pas nécessairement dans notre nature.
Je voudrais encore, par quelques exemples, vous montrer que votre thèse sur l’éthique de la considération pourrait acquérir bien plus de force si vous en éliminiez la référence à la théorie des pulsions et si vous y teniez compte de la maltraitance qu’a subie l’humanité, probablement depuis le néolithique.
Vous écrivez très justement que « la particularité de l’éthique de la considération consiste à faire du rapport à soi la clé du rapport à autrui ». N’est-il pas vrai que le rapport à soi est étroitement conditionné par le rapport à autrui qu’on a eu pendant toute la période de l’enfance ? Que des enfants qui ont été élevés par des adultes bienveillants et respectueux ont un rapport à eux-mêmes apaisé qui ne les pousse en aucune façon à dominer autrui ni à se soumettre à autrui. Ayant été élevés dans l’égalité de droit et dans le respect, ils respectent spontanément les autres.
Il est tout à fait vrai « qu’il n’y a pas d’autre point, premier et ultime, de résistance au pouvoir politique que dans le rapport de soi à soi. » (p. 75). Mais c’est précisément ce rapport qui est profondément perturbé par les relations de domination imposées et subies dans l’enfance. Il n’est pas étonnant que la majorité du peuple allemand se soit soumise à Hitler quand on sait à quel point la discipline familiale et scolaire en Allemagne était violente et impitoyable.
Vous dites très bien que « l’amour est déjà de la considération ou il est une voie vers elle ». Mais qu’en est-il de l’amour mêlé de violences et de jugements ? Il pervertit la conception que les enfants se font de l’amour et il explique certainement en grande partie la violence sur les femmes : « Je t’aime donc je te bats », c’est la leçon apprise sous la trique des parents.
Il faut associer « émancipation des individus et volontarisme politique » (p. 287). Oui. Les mesures politiques en faveur du respect des enfants, comme par exemple l’interdiction de la violence éducative, favorisent l’émancipation des individus. Respectés, les enfants conservent leur intégrité, leurs capacités relationnelles intactes.
J’ai grandement apprécié votre idée de présenter le nouveau-né comme « une aide, un point de repère », « le visage de la considération » qui « peut sauver le monde de la ruine et incarne la promesse de renouvellement du monde » (p. 286). Mais il faudrait ajouter qu’il ne « peut nous aider à résister à l’économisme et aux tentations totalitaires » que dans la mesure où il est respecté tout au long de ses années de formation et où on ne lui attribue pas des « pulsions » destructrices alors qu’il est au contraire parfaitement équipé pour mener une vie sociale enrichissante pour tous. N’y a-t-il pas une contradiction profonde entre ce bel éloge du nouveau-né et l’affirmation des forces destructrices dont il serait porteur ?
« Réunissant dans une sorte de concile les philosophes du passé qui ont élaboré une éthique des vertus, nous leur avons posé des questions qui sont celles de notre époque. » (P. 274.) C’est une démarche intéressante, mais il faut tenir compte du coefficient de déformation que l’éducation qu’ils ont subie a pu provoquer dans leur pensée et du fait qu’ils ont été en général aveugles à ce que subissaient les enfants autour d’eux et à ce qu’ils avaient eux-mêmes subi. Cet aveuglement s’explique très simplement par l’attachement viscéral des enfants à leurs parents. Cet attachement est si extrême, si vital (pour le bébé, l’abandon c’est la mort), qu’il empêche de voir la violence des parents comme un mal. Les enfants, même victimes de violences extrêmes, ne dénoncent jamais leurs parents. Et en plus ils s’accusent eux-mêmes d’être responsables des justes violences qu’ils ont subies. Les philosophes, si grands qu’ils soient, n’échappent pas aux effets de cet attachement.
« Il est important de former l’esprit critique des individus dès le plus jeune âge. » (P. 230.) Oui, mais surtout prendre soin de ne pas les former à l’obéissance comme on l’a fait depuis des millénaires, ce qui a fait taire pendant longtemps l’esprit critique.
« C’est, dites-vous, parce que le mal est en nous, et pas seulement à l’extérieur de nous, et que des forces puissantes s’opposent à la considération, qu’il est nécessaire de recevoir une éducation faisant appel aux émotions, à l’imagination morale et au langage. » (P. 228.) Non, le mal n’est pas en nous. Du moins, il n’est pas dans les enfants, il n’est pas inné. Et avant d’éduquer les enfants en faisant appel aux émotions, à l’imagination morale et au langage, il faut d’abord être attentif à leurs émotions, à leurs capacités, à tout ce qu’ils portent déjà en eux de favorable à une bonne relation avec leurs semblables.
« Rousseau enseigne à Émile la compassion par des actes de l’imagination que ne corrompt pas la rivalité. » (P. 218.) Plutôt que d’enseigner la compassion, observer la compassion dont sont capables les enfants à l’égard de qui on a été compatissant et empathique. Quant à « l’ouverture à autrui par-delà les frontières », c’est l’exemple du comportement de leurs parents qui pourra les aider à respecter l’altérité, à ne pas opposer « nous » et « eux ». Connaissez-vous l’enquête de Samuel et Pearl Oliner sur la personnalité altruiste ?
« Nous pouvons faire nôtre la protestation de Rousseau contre l’éducation bourgeoise : utilisant les réprimandes ou les honneurs […]. Fondée sur l’amour-propre, elle sème dans les âmes la crainte et produit des individus anxieux et enclins à la servilité et à la flagornerie envers l’autorité. » (P. 217.) En citant Rousseau, vous dites vous-même ici qu’une éducation répressive peut avoir un effet délétère sur les enfants. Cet effet, même Rousseau ne l’avait pas vu dans son ensemble, probablement parce que son père était lui-même violent et qu’attaché à lui, il n’a pas été capable de le remettre vraiment en question. Il ne déconseille de frapper les enfants que parce que c’est inefficace, et une note de son Émile montre qu’il n’est pas du tout opposé à l’emploi des châtiments corporels dans certaines circonstances.
« Il importe d’éveiller en eux le désir de s’entraider. » (P. 215.) Le désir de s’entraider, il est déjà naturellement chez les enfants, de même que la capacité d’aimer. Il suffit de les cultiver par l’amour et l’entraide qu’on manifeste à leur égard.
« Il y a toujours un conflit entre l’individu et la société, en raison de la tension existant entre les revendications individuelles et les exigences sociales, et ce conflit reproduit celui qui existe chez l’individu et correspond à l’économie de sa libido. Ainsi la lutte éternelle entre la pulsion de vie et la pulsion de mort est-elle transposée dans la vie en communauté. » (P. 210.) Je crois au contraire que nous naissons remarquablement équipés pour la vie sociale. L’ego n’est pas égoïste. Il le devient si l’éducation ne le respecte pas et si l’éducateur lui-même ne se respecte pas, c’est-à-dire n’a pas la présence à soi nécessaire pour être capable de dire non à l’enfant quand c’est nécessaire. Et à propos de présence à soi, connaissez-vous le livre de Michel Terestchenko, Un si fragile vernis d’humanité ?
Je serais très heureux de savoir ce que vous pensez de tout cela, non dans un esprit de polémique mais parce que j’ai beaucoup apprécié la plupart de vos idées et que je regrette que certaines d’entre elles ne m’aient pas permis d’y adhérer entièrement.
‹ Encore la résilience… Un Dictionnaire du fouet et de la fessée ›